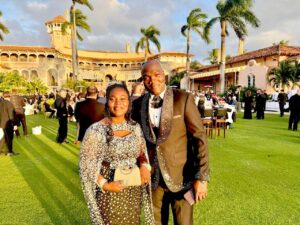La Commission de la CEDEAO, par l’intermédiaire de sa Direction de l’énergie et des mines, en collaboration avec la Banque mondiale, a entamé une mission d’évaluation semestrielle de quatre jours du projet régional d’accès à l’électricité et de technologie de stockage d’énergie par
batterie (BEST), le 23 septembre 2025 à Abuja, au Nigeria. Cette mission sert de plateforme pour évaluer la pertinence, l’efficacité et l’efficience du projet, tout en identifiant les défis liés à sa mise en œuvre et en fixant les priorités pour la phase suivante.
Le projet BEST, entièrement financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par la CEDEAO dans toute la région, vise à accélérer l’accès à l’électricité, à renforcer la stabilité du réseau, à améliorer l’intégration des énergies renouvelables et à améliorer les conditions de vie des populations en Afrique de l’Ouest.
Lancé le 30 mars 2022 avec un budget de 465 millions de dollars, le projet couvre le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Niger et la Côte d’Ivoire. Ses principaux objectifs sont l’électrification de 2201 localités, l’installation d’une capacité de stockage de batteries de 205 MWh et le raccordement de plus de 235 000 foyers à des services électriques modernes.
Dans son discours d’ouverture, M. Bayaornibe Dabire, directeur de l’énergie et des mines de la CEDEAO, a réaffirmé l’engagement de la Commission envers le projet :
« Depuis son lancement en 2022, le projet BEST nous a rassemblés avec rigueur, enthousiasme et cohérence. Nous sommes à mi-parcours, et cet examen nous permet de réfléchir à nos succès et à nos défis, de réajuster nos priorités et de renforcer notre solidarité régionale. Malgré les difficultés, des résultats tangibles sont déjà visibles, et l’impact sur les ménages et les communautés sera transformateur ».

M. Dabire a souligné l’importance d’améliorer la gestion technique des risques, de rationaliser les procédures et de tirer parti des expériences réussies des pays, en particulier en Côte d’Ivoire, afin d’accélérer la mise en œuvre dans les autres pays.
Le directeur Dabire a noté des progrès importants dans tous les États membres. En Côte d’Ivoire, le volet stockage est achevé à 81,5 %, avec trois sites (105 MWh) dont la mise en service est prévue d’ici mars 2026. Le Sénégal a achevé les études pour électrifier 1 041 communautés (plus de 50 000 ménages), la construction devant commencer après la saison des pluies. Au Sahel, le Mali a signé des contrats pour un système de stockage de 80 MWh (juillet 2025), le Niger a attribué des contrats couvrant 91 % des engagements (95,4 millions de dollars), dont 742 communautés et un système de 20 MWh, tandis que la Mauritanie a atteint 48 % d’avancement dans les travaux d’accès pour 481 communautés malgré des difficultés techniques. Au niveau régional, l’Unité de coordination régionale (RCU) travaille avec les unités de mise en œuvre nationales (PIU) pour accélérer les décaissements et la mise en œuvre.
Mme Elise Akitani, spécialiste principale en énergie à la Banque mondiale, a souligné que le projet BEST, d’un montant de 465 millions de dollars, permettra d’étendre les connexions au réseau dans trois pays, de renforcer les capacités de l’ERERA et de consolider les opérations du réseau d’interconnexion du WAPP grâce au stockage d’énergie par batterie. Elle l’a décrit comme une étape pionnière vers une production, un transport et des investissements accrus dans les énergies renouvelables, ainsi que vers le développement d’un marché régional de l’électricité à fort potentiel pour le secteur privé en Afrique de l’Ouest.
Cet examen à mi-parcours marque une étape cruciale pour garantir la réalisation des objectifs du projet BEST. À l’achèvement du projet, l’Afrique de l’Ouest devrait bénéficier d’une couverture électrique rurale élargie, d’une augmentation du taux d’accès à l’électricité et d’une meilleure stabilité du réseau dans l’ensemble du West African Power Pool (WAPP), d’une plus grande intégration des sources d’énergie renouvelables et d’un modèle concret d’intégration énergétique régionale.
@ECOWAS